|

Améziane Mehenni , fils de l'artiste
militant berbère Ferhat Mehenni, assassiné à Paris en ce mois de juin 2004. Plus d'information: www.makabylie.com
Nos sincères condoléances
Améziane Mehenni a été arraché à son père 48h avant la fête des pères. Quelle cruauté! Son assassinat est tombé comme un couperet sur nos frêles épaules encore meurtries. Épaules frêles d’un
peuple qui a tant donné à l’Algérie et aux valeurs qui sont sensées être les piliers d’une république démocratique
et populaire. Devant une telle horrible nouvelle, on ne peut que s’incliner devant la mémoire d’un jeune kabyle
arraché à la fleur de l’âge à sa famille, ses amis et ce combat noble que
mène la Kabylie depuis plus de 40 ans pour réhabiliter ce qu’elle est et sauvegarder ce qu’elle a. Quoi dire à
Ferhat Mehenni le père? Quoi dire à Ferhat Mehenni le militant ? Quoi dire à Ferhat Mehenni l’artiste? Trois questionnements
pour s’adresser en fait à une seule personne qui a sacrifié sa jeunesse et va vie pour que vive Tamazight et les droits
de la personne en Algérie.
Aujourd’hui Ferhat a très mal. Sa famille aussi. Mais il n’est pas seul. Il ne sera jamais
seul. Toute la Kabylie est avec lui. Nous sommes toutes et tous ses enfants. Toute la Kabylie a partagé sa douleur et lui
a exprimé ses condoléances, chacun à sa manière. La Kabylie est là comme ‘’un seul homme’’ pour supporter
la famille Mehenni dans sa douleur extrême. Certains nationalistes fascistes ne comprennent pas cette culture d’être
là ensemble et tout de suite quand les circonstances l’exigent et ce, malgré nos
divergences. Il y a certes de la colère vu l’ampleur du choc. Il y a certes de la suspicion vu la nature du régime algérien
qui est derrière toute une série de crimes indécents qui ne cessent d’endeuiller cette région rebelle et résistante.
Mais, il y a aussi cette soif de vérité et ce vœu inébranlable que justice soit faite qui animent les Kabyles. Il faut
que la justice française fasse toute la lumière sur ce crime lâche et crapuleux.
On a tendance à rendre hommage aux morts, à leur être reconnaissants une fois partis.
Erreur! Désormais, nous devons rehausser le combat des nôtres en leurs vivants. Ferhat Mehenni, vous n’êtes pas seul.
Nous sommes avec vous. Nous sommes tous et toutes des Améziane.
Toutes nos condoléances à votre famille
Que Dieu accueille Amézaine en son vaste paradis
Que ses rêves qui sont les nôtre soient exaucés
Tirrugza, Montréal 2004

HOMMAGE À MATOUB LOUNÈS
Montréal, samedi 26 juin à 19h 30 au 415 Saint Roch ( Métro Parc)
Ma patrie, cest ma mémoire
«Mais puisque les
Kabyles sunissent, ils dissiperont nos funestes tares. À quoi bon les vains verbiages : Tamazight est le socle
de leur avenir , elle est la racine de leur vie()».
«Et vous entendrez les jeunes enfants chanter la terre de Timuzgha;
lhéritage de Mouloud Mammeri, comme la foudre dans le ciel éclate; en sentez-vous la bruine couler?». «Honorable terre des
Chaouis, que de sang ici coula à flots lorsque commença la guerre! Par mes poèmes je loue votre valeur, faites-moi offrande
de votre deuil. Au cur aimant, il faut un compagnon» M. L
Timuzgha
Dire à nos enfants ce que nous sommes. Leur apprendre ce que nous avons.
Les préparer à assurer la pérennité de notre héritage pour les générations futures. Toute une mission pour le peuple berbère.
Un peuple qui a subi les affres des invasions multiples à travers les siècles et affronte ces dernières décennies les conséquences des exils forcés. Des exils!
Il y a dabord lexil intérieur.
Le Berbère vit certes dans son pays natal, ancestral, mais il est privé de son identité, de ce qui «fait de lui, lui » pour
paraphraser le dramaturge algérien M. Slimane Benaïssa. Cest-à-dire un être libre et digne avec sa langue et sa culture millénaire.
Le Berbère est appelé dune façon permanente à lutter pour arracher ce qui lui revient de droit dans un pays qui est le sien
et quil a libéré lui-même du joug colonial.
Il y a ensuite lexil extérieur. Pendant loccupation française, des milliers
dAlgériens, berbérophones notamment ont été déportés en Syrie, en Nouvelle Calédonie. Une autre partie a été contrainte de
regagner la France pour travailler et subvenir aux besoins des familles restées au Bled.
Il y a enfin, lexil de lâme. Ce dernier est le pire de tous. Attirés par
les privilèges matériels offerts par lAutre, nombreux sont les Berbères qui ont quitté leur peau pour habiter dans celle de
lAutre. Et cet Autre pourrait être un Romain, un Arabe, un Turc ou un Français
pour ne citer que ceux-là.
Heureusement quil y a dautres Berbères intègres et courageux à travers les
siècles. Cest grâce à eux que Tamazight demeure éternelle. Elle habite désormais leur tête et leur cur à travers le monde.
Matoub Lounès fait partie de ces vigiles de la mémoire berbère. Nous aussi, apprenons à nos enfants ce que nous sommes pour
quils le transmettent à leur tour à leur progéniture.
Pour immortaliser
le combat et le cri de lâme de Lounès, lAssociation Culturelle Amazighe de Montréal Tirrugza
organise un hommage solennel en sa mémoire.
Montréal, Tirrugza, juin 2004
http://tirrugza.tripod.com
courriel : tirrugza@iquebec.com
Contact : (514) 593-1507
Hommage à Matoub Lounès
Regard sur luvre de Lounès Matoub
Programme
19H00 : Accueil
19H30 : Lecture de quelques poèmes consacrés à lartiste
défunt
19H 45 : Présentation du livre de Yala Sedikki : Mon Nom est combat
19H50 : Lecture de quelques poèmes de Matoub par les
enfants
20H15 : Projection du film kabyle Azal N Tsar ( Le
prix de la vengeance). Le film de Assam Hmimi est inspiré de luvre de Matoub
Lounès
21H : Pause
21H30 : Projection de lhommage rendu à Matoub au Zénith
23H : Fin de la soirée
Exposition des toiles de Tassadit Toursal
Entrée 10$ pour les adultes. Gratuit pour les enfants
24ème anniversaire du printemps amazigh ( berbère)
Les larmes de la Mémoire berbère
Le serment dun Combat
La Vie
Tafsut Imazighen/Le Printemps berbère
La souffrance est tellement aiguë que la mémoire amazighe
( berbère) pleure silencieusement. Les injustices envers notre identité sont tellement cruelles que le serment d'un combat pour
la réhabilitation de notre histoire doit se maintenir voire être entretenu. La vie est tellement belle que la sagesse,
la tolérance et le respect de la différence doivent avoir le dessus sur les extrêmismes de tous bords. En effet, devant la
complexité machiavélique des politiques algériennes et nord-africaines, devant
lampleur des enjeux politiques, idéologiques et économiques dans cette région belle, riche et prospère, la démarche du combat
amazigh et des droits de la personne doit se doter désormais de stratégies rassembleuses et porteuses pour que son objectif
suprême aboutisse : Tamazight nationale et officielle en Algérie et au Maroc. Pour ce faire, Tamazight doit être au dessus
des ambitions personnelles et claniques.
En ce 24ème anniversaire du Printemps Amazigh,
on ne peut pas laisser passer sous silence les sacrifices des enfants de cette région nord-africaine, méditerranéenne depuis
des siècles; le combat des militants amazighs algériens, marocains, tunisiens et libyens
qui ont subi les affres des prisons et la solitudes des cachots noirs et humides des pouvoirs totalitaires et anti-berbères.
En ce 24ème anniversaire du Printemps Amazigh,
on ne peut pas oublier la résistance de la reine des Aurès Dyhia ( Kahina) contre l'intrus, l'envahisseur; la détermination
et le dévouement exemplaire de Mohand U Haroun, de Kaci Lounès et de leurs compagnon de lutte à défier la dictature de Boumediene
dans les années soixante-dix; le courage explosif et historique des jeunes Universitaires algériens de 1980 en Algérie, la
Kabylie et l'Algérois notamment.
En ce 24ème anniversaire du Printemps Amazigh,
on ne peut pas omettre de rendre hommage aux victimes du Printemps
Noir de Kabylie, à cette Kabylie qui s'accroche
jalousement et dignement à son identité et à la démocratie dans son Algérie juste
et plurielle; à l'élan de solidarité des frères amazighs des Aurès et du Maroc; au soutien de tous les militants-es des droits
de la personne et des peuples à travers le monde.
En ce 24ème anniversaire du Printemps Amazigh,
3ème anniversaire du Printemps Noir de Kabylie, nous devons être reconnaissants envers nos parents, nos intellectuels,
nos penseurs, nos écrivains, nos politiques, nos journalistes et nos artistes qui ont travaillé très dur pour préserver notre
mémoire, bâtir notre présent et assurer notre avenir en tant que peuple qui a sa terre, sa langue, sa civilisation, sa mémoire
et sa culture.
En ce 24ème anniversaire du Printemps Amazigh,
nous devons perpétuer ce combat intelligent et pacifique de nos aînés-es pour contrer les détracteurs de notre cause, transmettre
les valeurs universelles à nos enfants tout en demeurant nous mêmes, amazighs, libres et souverains en Afrique du Nord et
dans le monde. Nous devons rehausser notre identité partout où nous vivons, car, nous sommes tous et toutes les Vigiles de
notre mémoire millénaire.
Tirrugza,
Montréal 18 avril 2004
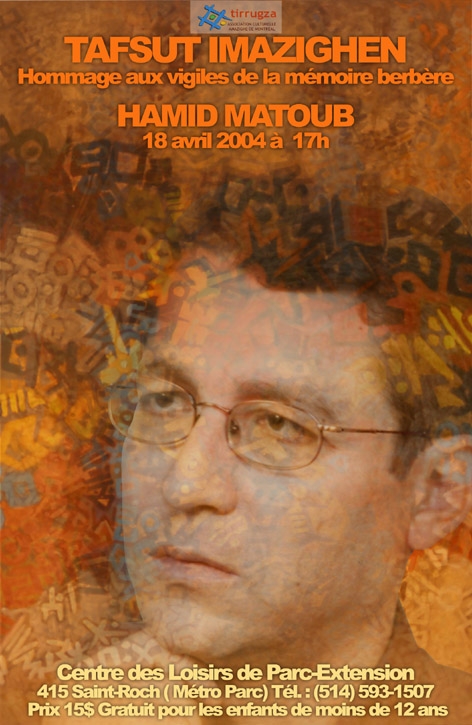
Programme
Animation : M. Lhacène Ziani
16H : Accueil
17H30 : Mot de bienvenue
17H35 : Déclaration en Tamazight par Madjid Ben Belkacem
17H40 : Projection dun documentaire de Ali Mouzaoui sur
Mouloud Mammeri
18H10 : Déclaration en Français par Djamila Addar
18H15 : Danse sur les chants de la joie de Taos Amrouche
par Azetta
18H30 : Chants avec
Hakim Kaci
18H 45 : Spectacle avec Hamid Matoub
20H30 : Pause
20H45 : Spectacle avec Hamid Matoub
22H00 : Fin de la soirée
Boissons et Sandwichs seront servis pendant la pause
Les billets seront vendus à partir de samedi 03 avril 2004
Laffiche est conçue et réalisée par lartiste peintre Ali Kichou.
Accueil : Taos Hafed, Sifax Nekka et Hamida Gaci
Contacts :
Tarik Meddour :
(514) 529-6207
Djamila Addar :
(514) 593-1507
NB: vous pouvez réserver vos places à lavance

À la mémoire de Mammeri lAmusnaw
Tirrugza présente
Documentaire : Hommage à Mouloud Mammeri du réalisateur algérien Ali Mouzaoui
Date, heure et lieu : 29
février 2004 à 15H au 415 Saint Roch, Parc-Extension
Prix : 5$ pour les adultes, gratuit pour les enfants de 15 ans et moins.
Dans ce documentaire, produit par la télévision algérienne, ENTV, Ali Mouzaoui
fait parler ceux qui ont vraiment lu et saisi les messages de Mammeri comme Tahar Djaout, Rachid Mimouni etc Il nous montre
des images émouvantes de son enterrement dans sa Kabylie natale. Il nous transporte également dans le monde des Berbères du
Sud dAlgérie que Mammeri avait côtoyés et aimés. Mais, ne dit-on pas que limage vaut mille mots? Il faut venir voir le film
Présentation
de lécrivain :
Mouloud
Mammeri
Le chercheur et romancier est mort en février 1989
La force tranquille
Mouloud Mammeri a fini par incarner un symbole pour la génération des Algériens
des années post-1980, le symbole de la revendication de l'identité berbère par son substrat intellectuel tant l'homme, l'érudit,
possédait cette force tranquille du chercheur qui, pas à pas, a construit les repères essentiels d'une culture fondatrice
de l'amazighité en renouvelant dans la diversité des disciplines (sociologie, anthropologie, linguistique, littérature, essais)
les contenus et les approches dans un mouvement d'ensemble cohérent.
Ce substrat intellectuel prend sa source des premiers
écrits sur le concept d'identité, en 1938, dans la revue marocaine Aguedal consacrés à la société berbère. Ses recherches
ininterrompues sur le concept de l'identité en général, et de l'identité berbère, en particulier, naîtront des réalités historiques
et sociologiques à travers sa trilogie La Colline oubliée, Le Sommeil du juste et L'Opium et le Bâton ; romans dans lesquels
se profile une identité du terroir déjà en conflit avec l'inévitable acculturation des personnages principaux propulsés hors
de la terre natale. Cette trilogie sera suivie de La Traversée (1982), le premier roman urbain de Mammeri qui élargit la dimension
de l'identité aux confins du Sud algérien auquel il a consacré l'Ahellil du Gourara, une étude ethnomusicologique sur ce chant
traditionnel que symbolise, dans ce roman, l'aède Ba Salem qui répond de loin en loin à Si Mohand U Mhand auquel, pour la
première fois, Mammeri a conçu l'un des recueils de poèmes les plus exhaustifs après Boulifa et Mouloud Feraoun. Cette interpénétration
entre le roman et le recueil de poésies sauvées de l'oralité dans la lignée des transmetteurs connaîtra une autre dimension
dans cette quête savante de l'identité, en ses éléments fondateurs et en ses interrogations essentielles : la linguistique.
En effet, dès 1974, suite aux Isefra de Si Mohand (Maspéro, 1969) auquel il fallait une base transcriptive, Mammeri élabore
La Grammaire kabyle entièrement rédigée en berbère pour ensuite être traduite en langue française. Cet alphabet gréco-latin
qui lui est propre, même s'il tient, pour une large part, des premiers transcripteurs berbères, comme Si Saïd Boulifa, Hanoteau
et les travaux menés par les Pères blancs du Centre de documentation de Fort national (Larbâa Nath Irathen ) dont il ne reste
plus rien aujourd'hui, deviendra tamaârit (le genre de transcription élaboré par Mammeri) toujours de rigueur dans les concours
annuels organisés par la Fédération des associations culturelles qui a institué un prix portant son nom aux écrivains en herbe
de culture amazighe. L'homme de lettres, l'anthropologue, ne s'arrêtera pas au formalisme linguistique ni à la fiction romanesque.
L'espace identitaire dans lequel se déploie son érudition convoque le genre ardu, l'essai à caractère anthropologique : Poèmes
kabyles anciens qui sera interdit de conférence à l'université de Tizi Ouzou en 1980 et Yenna ya Cheikh Mohand. Dans le premier
recueil, il offre une vision critique et dynamique du rôle de la socio-anthropologie. Il relève, avec pertinence, le caractère
figé que la science coloniale avait sur l'identité autochtone en « réduisant les poèmes à des feuilles mortes ». Dans ses
entretiens avec Pierre Bourdieu, Du bon usage de l'ethnologie, il considère que seul le regard de l'autochtone sur soi est
pertinent dans cette science qui a longtemps servi d'alibi colonial, considérant la société algérienne dans son état de «
soumission ». L'esprit Mammeri est cette rencontre des disciplines littéraire, linguistique et anthropologique qui s'interpénètrent
dans une même sphère identitaire hors de ses étroitesses géographiques et idéologiques.
Rachid Mokhtari
Repères
1917 : Né le 28 décembre 1917, décédé en février 1989 victime d'un accident
de circulation de retour d'Oujda où il avait participé à un colloque sur la culture amazighe.
1938 : publication d'une série d'articles sur la société berbère dans la
revue marocaine Aguedal.
1940 : Démobilisation du front de la Seconde Guerre mondiale.
Il poursuit ses études entamées au Maroc au lycée
Louis-Gouraud à l'ex-lycée Bugeaud (Emir Abdelkader) et
prépare l'école normale supérieure.
1947 : Enseignant à Médéa puis à Ben Aknoun (Alger) après
avoir réussi le professorat de lettres.
1952 : Publication de La Colline oubliée chez Plon
1953 : Prix des Quatre Jurés.
1955 : Publication du Sommeil du juste (Plon).
1957 : Ciblé par l'armée coloniale, il se réfugie au Maroc
1965 : L'Opium et le Bâton (SNED).
1969-1980 : Il dirige le Centre national de recherches
anthropologiques, préhistoriques et ethnologiques, le CRAPE. Il publie Les Isefra de Si Mohand et élabore un lexique en tamazight
: Amawal. Il crée, parallèlement, la revue Lybica, un bulletin scientifique daté de 1953 auquel il donne une orientation scientifique.
1974 : Il élabore sa grammaire berbère qui sera rééditée
chez Bouchène en 1992.
1980 : Parution de Poèmes kabyles anciens à l'origine
du Printemps berbère de Kabylie.
1982 : Il fonde à Paris le Centre d'études et de recherches
amazighes, le CEDAM, et crée la célèbre revue Awal.
1988 : Il reçoit le titre de docteur Honoris Causa à l'université
de la Sorbonne, à Paris. 1989 : Avant sa mort accidentelle, il accorde un long entretien à Tahar Djaout sur l'écriture
comme espace identitaire.
1991 : Création du prix annuel Mouloud Mammeri par la
Fédération des associations culturelles.
Bonne année 2004
Assugas
Ameggaz 2954!
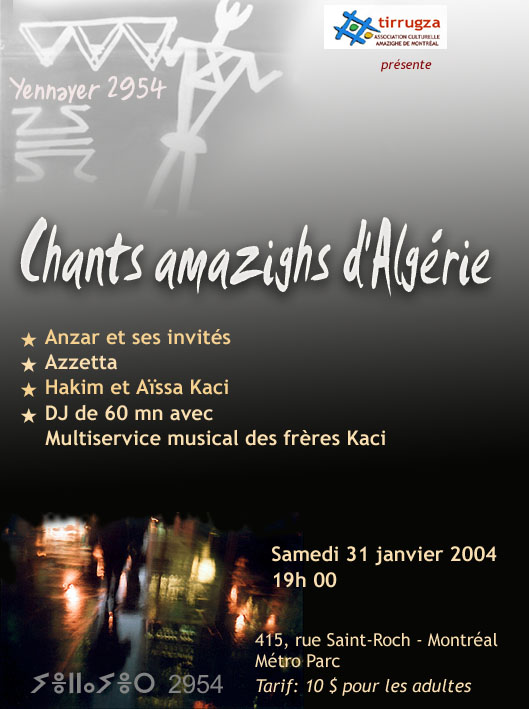
Bonne année 2004
Assugwas Ameggaz 2954!
Tirrugza célèbrera Yennayer ''Nouvel An Amazigh'' ce samedi 31 janvier 2004 à 19H au 415 Saint Roch, Métro Parc.
Entrée 10$
Venez nombreux et nombreuses à vivre Yennayer avec nous et à apprécier les talents nos artistes.
Au programme
Azetta
Anzar et ses invités
Hakim et Aïssa Kaci
DJ de la Boite Multiservice musicale des frères Kaci
Tirrugza vous souhaite une année pleine d'espoir, de paix et de prospérité.
nos meilleurs voeux à tout le monde et à toutes les associations qui oeuvrent dans le sens de semer la fraternité, les
rapprochements et la sérénités entre les enfants dAlgérie quelle que soit leur langue, leur confession ou leur origine.
Nous profitons pour vous souhaiter Un Nouvel An amazigh ( Yennayer ) radieux que tous les Nord-africains fêtent à
travers les siècles. Ce mois de janvier 2004, à linstar des Villes nord-africaines, Paris, Montréal et Ottawa fêteront Yennayer.
Il est temps pour les Nord-africains de se retrouver, de se réconcilier avec leur mémoire millénaire. Car, au delà d du fait
de fêter un évènement comme Yennayer, il serait judicieux de le vulgariser auprès des enfants de la Numidie. Combien même
de gens du ''Maghreb'' qui fêtent Yennayer sans savoir quil sagit en fait du Nouvel An Amazigh.
EVÉNEMENT
dimanche
11 janvier 2004
Le calendrier berbère entre emprunts et originalité
CONTRIBUTION
Le calendrier berbère est issu
du calendrier julien mais il n'a emprunté à ce calendrier que la division de l'année en 12 mois et la dénomination de ces
mois :les rites, les croyances et l'esprit du calendrier sont berbères. Les calendriers officiellement utilisés en Algérie
et au Maghreb sont le calendrier grégorien (appelé parfois "universel") et le calendrier hégirien ou musulman. Ils sont utilisés
conjointement dans les documents officiels mais en réalité le calendrier grégorien est le plus employé, le calendrier hégirien
ne servant pratiquement qu'à la vie religieuse. Les paysans emploient, pour leurs travaux, un autre comput, le calendrier
julien ou calendrier agraire, appelé souvent en Algérie calendrier berbère. Dans certaines régions, notamment au Maroc, on
connaît une division de l'année en mansions lunaires, les fameux manâzil de la tradition astrologique musulmane, mais interprétée
selon les croyances berbères. Enfin, on relève un peu partout un cinquième calendrier, appelé "calendrier des femmes", qui
emprunte ses dénominations au calendrier musulman et qui sert le plus souvent à déterminer les fêtes religieuses (Achoura,
Mouloud. . . ) et à calculer les grossesses.
ORIGINE du calendrier berbère
Le
calendrier agraire ou julien, qui nous intéresse ici, tire son origine, ou plutôt l'origine des dénominations de ses mois,
du calendrier romain établi en 45 avant J-C sous le règne de l'empereur Jules César dont il porte le nom. Les Romains avaient
d'abord utilisé un calendrier lunaire de 304 jours répartis en dix mois de 30 ou 31 jours. L'année commençait théoriquement
à l'équinoxe de printemps (mars) mais à cause de la courte durée de l'année civile, chaque mois passait par toutes les saisons.
Vers 600 avant J-C, Numa fit porter l'année à355 jours, répartis en 12 mois de 28, 29, 30 ou 31jours. On ajouta plus tard
un treizième mois intercalaire de 22 ou 23 jours. Ces réformes compliquées étaient loin d'être comprises de tous les Romains
et il subsista dans le calcul de l'année de grandes discordances. On en vint à célébrer les fêtes du printemps en automne
et celles de l'automne en hiver. Jules César entreprit en 45 avant J-C. une profonde réforme conseillée par l'astronome Sosigène
d'Alexandrie. Il divisa l'année en 365 jours un quartet, pour compenser ce quart, on ajouta, tous les quatre ans, un jour
supplémentaire. On baptisa le septième mois du calendrier (mois appelé quintilis) et on lui donna le nom de César, julius,
en français juillet. Pour rattraper le retard causé par le calendrier antérieur, on ajouta 85 jours à l'année 46avant J-C.
En 7 avant J-C., on réajusta de nouveau le calendrier : le huitième mois, sextilis, qui devint augustus, août, en l'honneur
d'Auguste, devint un mois de 31 jours. En même temps, le début de l'année fut ramené du 1er mars au 1er janvier.
Malgré les soins qu'on avait mis à l'élaborer, le calendrier julien accusait toujours
un retard de quelques minutes paran. En 326, quand le concile de Nicée l'adopta et l'imposa au monde chrétien, l'écart atteignait
quatre jours. L'Eglise rattrapa le retard mais le calendrier continua à dériver si bien qu'à la veille de la réforme grégorienne,
il accusait un retard de dix jours sur le temps réel. On craignait de devoir bientôt célébrer la fête printanière de Pâques
en été ! C'est alors qu'on émit l'hypothèse d'une correction. Le pape Grégoire XIlI, qui régna de 1572 à 1585, mit au point
la réforme. Il donna à l'année une durée de 365 jours 5 heures 49 minutes et 12 secondes, avec un jour supplémentaire, placé
en février, tous les quatre ans. Pour effacer les 10 jours d'écart du calendrier julien, on passa le jeudi 4 octobre 1582
au vendredi15 octobre. L'Angleterre, hostile à la papauté, n'adopta la réforme grégorienne qu'en 1751. En Angleterre, le lendemain
du 2 septembre 1752 fut le 14et non le 13, car le calendrier julien avait perdu entre-temps un autre jour. Le premier jour
de l'An berbère est fêté actuellement le 12 janvier mais en réalité l'écart, de 1582 à nos jours, n'est pas de deux jours
mais de trois car il y a un retard d'un jour tous les 128 ans ou de trois jours tous les 400ans, en supprimant trois jours
bissextiles.
Le calendrier julien s'est répandu au Maghreb durant la période romaine. Son influence
ne s'est pas limité eaux centres de colonisation puisque les dénominations de ses mois se retrouvent partout y compris dans
les régions qui, comme le Sahara, ont échappé à la conquête romaine. La conquête arabe le chassa des villes et de l'administration
où elle le remplaça parle calendrier hégirien, mais il demeura dans les campagnes parce qu'il est plus conforme aux rythmes
des travaux agricoles que le calendrier arabe lunaire qui ne tient pas compte des saisons. Ce phénomène n'est pas particulier
au Maghreb puisqu'on le retrouve en Égypte, principalement chez les Coptes, chrétiens, mais aussi chez les populations musulmanes.
Il a été perpétué par les ouvrages d'agriculture et d'astrologie populaires, notamment le Kitâb al Filah'ad'Ibn Al Aawwâm
qui recense les légendes attachées aux rites et aux festivités agricoles. Ces ouvrages furent largement répandus au Maghreb
où les zaouïas, principaux centres de diffusion du savoir dans les campagnes, les utilisèrent pour mesurer le temps. Les noms de mois juliens utilisés au Maghreb sont si proches des formes égypto-coptes
qu'un auteur comme Jean Servier pense que le calendrier julien maghrébin n'est pas un legs de la période romaine mais a été
mporté par les Arabes. En fait, les noms de mois julien se retrouvent non pas seulement dans les régions du nord du Maghreb
où l'influence des zaouïas est importante mais aussi dans les régions les plus reculées, notamment chez les Touaregs. Il faut
donc croire à un emprunt ancien auquel se seraient superposés, dans certaines régions, des emprunts au calendrier égyptien.
Par contre, l'influence de ce calendrier paraît évidente dans la dénomination de certaines périodes : Al A'zaria, Nissan,
Al Ins'raetc., dénominations qui proviennent pour la plupart du calendrier babylonien. D'ailleurs, des légendes et des mythes
explicatifs de certaines périodes du calendrier se retrouvent hors de l'ère berbère. C'est le cas du mythe de la vieille
que l'on retrouve aussi bien au Maghreb qu'en Egypte, en Calabre et en Provence. Perette
Galand Pernet a effectué à ce sujet une vaste enquête où elle a montré la grande antiquité de ce mythe et son extension dans
le monde méditerranéen.
Revenons
au calendrier berbère. Les noms de mois sont donc empruntés au latin et ils sont à peine modifiés ainsi que le montre la liste
suivante des dénominations dans les dialectes berbères et en arabe dialectal : Janvier : Latin, januaris mens, mois de Janus,
berbère : Yannayer, Nnayer (kabyle), ennayer (Maroc centraI), Innayer (Chleuh), Innar (Touareg) ;arabe dialectaI : Yeneyar,
Yannayar. Février : Latin, fébruarius mens, mois de la purification, berbère :Furar (kabyle), Febrayer (Maroc centraI), Khubrayer(Chleuh),
Forar (touareg) ; arabe dialectaI : Frayer.Mars : Latin, Mars, mois du dieu Mars, berbère :Meghres (kabyle), Mars (Maroc central,
hleuh,ouareg) ; arabe dialectaI : Mars. Avril : Latin,Aprilis mens, berbère : Yebrir, Brir (kabyle), lbril(Maroc centraI),
Ibrir (Chleuh), Ibri (Touareg) ;arabe dialectal : Abril. Mai : Latin, Maïus, mois dela déesse Maïa, berbère : Mayyu, Maggu
(kabyle), Mayyu (Maroc central), Mayyu (Chleuh), Mayo (Touareg) ;arabe dialectal : Mayyuh. Juin : Latin, Junius, mois de Junon,
berbère : Yunyu, Yulyu (kabyle), Yunyu (Maroc centraI), Yulyu (ChIeuh), Yunioh (Touareg) ;arabe dialectal : Yunyoh. Juillet
: Latin, Julius,mois de Jules César, berbére : Yulyuz (kabyle),Yulyuz(Maroc centraI), Yulyuz (ChIeuh), Yulyez(Touareg) ; arabe
dialectaI : Yulyuh. Août : Latin,Augustus, mois d'Auguste, berbère : Ghucht (kabyle,Maroc central, Chleuh), Ghuchet (Touareg)
; arabedialectal : Ghucht. Septembre : Latin, september, de septem "sept" parce que 7ème mois de l'année
juliennequi commençait en mars, berbère : Chtember (kabyle),Chutanbir (Maroc central, Chleuh), Chetember (Touareg); arabe
dialectaI : Chtember. Octobre : Latin,October, de octo, 8ème mois, berbère : Tuber, Ktober(kabyle), Ktuber (Maroc central,
Chleuh), Tuber(Touareg) ; arabe dialectal : Ktuber, Aktuber..Novembre : Latin, November, de novem, 9ème mois, berbère : Nwamber,
Wamber (kabyle) Ennwamber (Maroccentral, Chleuh), Wanber (Touareg) ; arabe dialectal :Nunember. Décembre : Latin, December,
de decem, 10ème mois, berbère : Djember, Dudjember (kabyle), Dujambir (Maroc central, Chleuh), Dejamber (Touareg)
; arabedialectal : Djanber
Rites
et croyances
Si le calendrier berbère a emprunté au calendrier julien sa nomenclature de mois, il
n'a repris ni ses festivités ni ses rites. Ainsi, on n'y trouve aucune trace
des calendes, des nonnes et des ides. Les rites et les festivités sont ceux de
la tradition berbère, tous en rapport avec les travaux de la terre et la symbolique
de la fertilité. Chaque mois, chaque saison correspond à une activité agricole. La détermination des saisons se fait à partir
des solstices pour l'hiver et l'été et des équinoxes pour le printemps et l'automne Mais, là aussi, on fait intervenir les
préoccupations et les travaux. Marceau Gast a parlé, à propos des touaregs de l'Ahaggar, d'un calendrier de la faim, c'est-à-dire
d'une division de l'année en fonction des disponibilités des ressources alimentaires ou de leur restriction. Ainsi, Tafsit,
le printemps, est l'époque de la floraison et des récoltes de l'orge et du blé, c'est donc une période faste. Ewilen, l'été,
est la saison chaude où l'on peut mourir de soif dans le désert. Awelan, l'automne, est l'époque de la récolte des dattes,
du mil et du sorgho, c'est une période d'abondance.
Tadjrest,
I'hiver, est la saison froide durant laquelle la sève ne monte plus dans les végétaux où la nourriture se fait rare. Cette
division se retrouve à peu près dans les régions du nord où les saisons sont liées aux activités agricoles et à l'abondance
ou à la restriction des ressources. Ainsi, le printemps, tafsut, dans tous les dialectes berbères, incarne le retour du beau
temps et une reprise des travaux, l'été est la saison des chaleurs mais aussi des récoltes et des moissons, l'automne la saison
des labours et de la cueillette des principaux fruits, l'hiver la mauvaise saison car elle est vide d'activités et symbolise
la restriction et même la famine. Les rites de Yannayer visent justement à rompre le cycle de la restriction et de la faim.
L'hiver n'est pas encore fini mais déjà on perçoit les prémisses de la belle saison. Si on procède à des sacrifices sanglants,
c'est pour fructifier la terre et la mettre sous la protection des forces bénéfiques, si on fait des repas copieux, c'est
pour augurer d'une année d'abondance, si on procède à des changements, comme le remplacement des pierres du foyer, c'est pour
annoncer le changement de cycle.
Chaque
saison est divisée en parties en fonction des activités ou des caractéristiques du climat. Chaque région a sa répartition
mais certains découpages sont communs. Ainsi, pour l'hiver, on relève partout une opposition entre deux grandes périodes :
les nuits noires, période la plus froide et la plus néfaste, et les nuits blanches, période d'accalmie, annonciatrice du retour
de la belle saison. C'est l'opposition desudhan iberkanen/udhan imellalen des Kabyles, erhedhsettefen/erherdh mellen des Touaregs,
lyalilkahla/ lyali Ibaydha des arabophones. Une autre période commune que l'on relève partout au Maghreb et au Sahara est
celle des jours fastes et néfastes : alhussum (les jours pénibles) au nord, sabaa (sous-entendu sbaa ayyam) au sud. Les dates
de cette période varient. Ainsi, à ldeles, en pays touareg, elles sont situées entre les quatre derniers jours de février
julien et les trois premiers jours de mars julien.
En
Kabylie où on appelle ces jours timgharines, les vieilles, la période varie du 28février au 5 mars juliens. Les croyances
pour la période sont les mêmes : il ne faut pas toucher aux instruments aratoires, il ne faut pas faire travailler les bêtes,
etc. Ces divisions des saisons et ces croyances sont certainement les bribes du calendrier berbère primitif, calendrier réglé
sur les rythmes des activités agricoles. La communauté des croyances, et parfois des dénominations, le fait remonter à la
préhistoire, en tout cas à la période antérieure à la division dialectale de la langue berbère. L'adoption du calendrier julien
n'a donc été que formelle puisque les Berbères n'ont emprunté aux Romains que la division de l'année en douze mois et les
dénominations de ces mêmes mois. Les rites, les croyances et l'esprit général du calendrier sont berbères. Ces rites et ces
croyances sont également transférés sur des fêtes musulmanes comme l'Achoura ou le Mouloud, intégrés dans la symbolique berbère
du renouvellement et de la fertilité de la terre.
M.A Haddadou,
universitaire et écrivain
SEMAINE QUÉBÉCOISE DES RENCONTRES INTERCULTURELLES
23-29 NOVEMBRE 2003
Dialogue
et rapprochement par les Arts
Tous les modes dexpression rapprochent les
gens et les cultures. Lexpression verbale ou écrite exige souvent la maîtrise des langues dans lesquelles sexpriment leurs
auteurs. De tous les temps, limage arrive à transcender toutes ces exigences pour frapper la perception de lil et la sensibilité
de lhumain. Parmi ces mode dexpression la peinture, la toile. On na pas besoin de comprendre le Chinois pour saisir les messages
dune toile. On a même cette marge de manuvre davoir sa propre lecture dune uvre donnée. Dans cette ère de mobilité internationale
qui a provoqué la recomposition de la société humaine, les arts visuels deviennent lun
des meilleurs facteurs rassembleurs des gens issus de cultures diverses.
Le phénomène du multiculturalisme- sil nest pas exploité à desseins politiciens ou folkloriques - prend toute son importance.
Il y va de même pour linterculturalité à condition quelle rapproche les cultures
et les pousse à conjuguer leurs efforts pour enrichir la création et rehausser lart dans toutes ses splendeurs.
Cest dans ce cadre et pour cet objectif sain
quune dizaine dartistes peintres dorigine algérienne et québécoise ont accepté de participer à la Semaine Québécoises des Rencontres Interculturelles organisée par lAssociation Amazighe ( berbère) de Montréal
Tirrugza et parrainé par le ministère des Relations avec les citoyens et de lImmigration
du Québec ( MRCI). En effet, le grand Hall du Centre des Loisirs de Parc-extension ( ex siège du ministère de lImmigration
du Québec) a abrité du 23 novembre au 06 décembre 2003 une grande exposition dArts visuels sous la direction de Ali Kichou.
Le vernissage de cette grande manifestation a coïncidé avec un grand gala qui a drainé plus de 350 personnes et qui est animé
par la troupe Azzetta ( chants et danses berbères dAlgérie) , groupe Anzar ( chants kabyles), groupe Alger Montréal ( chants
kabyles, rai et français) et Kamal Kouroughli ( chants chaâbi dAlger). Les spectateurs de tous âges ont non seulement contemplé
les uvres artistiques mais ont eu cette chance inouïe de parler et déchanger
directement avec les artistes, les auteurs de tous ces chef-duvres qui ont embelli lespace de quelques jours cette partie
multiculturelle de lîle de Montréal.

Exposition
darts visuels
Dés quon pénètre dans le Hall, ce sont les
uvres ( installations) de Ali Kichou qui nous accueillent. Une chaise magnifique, des masques dAfrique habillés en Tifinagh,
lAlphabet du peuple amazigh ( berbère) dAfrique du Nord interpellent lintelligence des visiteurs et suscitent leur curiosité. Le passé, la mémoire, lidentité et la détermination à assurer pacifiquement la pérennité
de la culture ancestrale transpirent des uvres de Kichou: «Les uvres
de Ali Kichou, naissent d'un entrelacement persistant de forces arcanes, de vérité et de magie. Ces libres agrégations de
symboles disposés de façon conceptuelle constituent une extraordinaire source d'enchantement poétique. Les innombrables "signes"
ne sont pas placés selon les effets du hasard mais ordonnés selon la loi rigoureuse de la composition
Préciosité et recherche formelle coexistent
dans son travail que l'on pourrait rapprocher des tendances informelles des années cinquante et qui n'est pas exempt d'éléments
traditionnels berbères, ce peuple opprimé par des stratégies politico-culturelles dominantes ().
À côté du génie de Ali Kichou sont exposées les toiles
de Yacine Brahami, de Hdjira Preure et de Sylvie Bouchard. Yacine Brahami insiste sur le caractère universel de ses uvres tout
en les imprégnant des couleurs de son pays dorigine lAlgérie: «Retrouver
létat desprit qui animait les primitifs dans leur quête du sacré lorsquils exprimaient
par le dessin les formes et les couleurs afin de nous transmettre leur vision du monde artistique, social et mystique. Dans ma recherche plastique, jutilise des teintes neutres qui saffirment par leur
simplicité et leur sobriété. Une peinture d innovation avec une allure moderniste et une vocation universaliste à la
céramique nord-africaine, mésopotamienne et chinoise. Elle est une forme décriture qui a une manière particulière de faire
redécouvrir les signes traditionnels dans une relecture qui les intègrent dans de nouvelles compositions abstraites. Pour
évoquer les richesses naturelles de la terre et les matières nobles, dans ma palette de couleurs jutilise des ocres, des rouges,
du brun, du noir et surtout du blanc qui est beaucoup plus mis en valeur car il est la couleur de léquilibre parfait. Dans
ma conception de lart, lexpression originale par la création personnalisée est fondée sur la contemporanéité artistique».
Sylvie Bouchard
devient dun coup voire paradoxalement lintruse parmi tant dartistes dorigine algérienne chez elle au Québec ! Mais, la
prestance du portrait dun homme quelle a rendu magistralement par la magie de ses mains la rend une intruse positive, ouverte.
Ce qui présage un bel avenir aux artistes qui viennent dailleurs et qui interpelle la famille artistique du Québec à souvrir
sur les génies issus des communautés qui composent la société québécoise daujourdhui : «Depuis
le début des années 80, mon travail s'inscrit dans une logique de représentation où se côtoie le réel et la fiction. Cette
démarche s'est élaborée à l'intérieur d'installations picturales réalisées dans les années 80. Celles-ci avaient la particularité
de prendre en charge le lieu d'exposition et de créer, selon la configuration même du lieu, un parcours dans lequel se déroulait
une fiction. Les tableaux que je peins aujourd'hui cherchent à rendre visible une construction de l'espace qui à l'instar
de ces installations picturales, témoignent encore de ce vif intérêt entretenu pour la création d'espaces fictifs. ()«Ces
fictions d'espaces picturaux sont des moyens que l'artiste utilise pour nous faire partager l'expérience d'une écriture qui
s'invente, nous faire sentir cette écriture se retourner sur elle-même, nous faire goûter au plaisir de se perdre et finalement,
nous permettre de nommer un lieu uniquement par ses couleurs.».
Hadjira Preure nous a éblouit
par la grandeur de ses toiles et surtout la douceur des messages que les couleurs choisies méticuleusement nous envoient :
«Pourquoi retranscrire les paroles dun philosophe en guise dintroduction à luvre de Hadjira Preure ? Peut-être parce que
pour elle la vérité a un sens dans la vie et une application cohérente outre que dans lactivité artistique. En effet, en agissant
dans le respect absolu dun impératif intérieur, Hadjira Preure arrive à donner vie à daudacieuses compositions qui évoquent
des forces pulsionnelles profondes. Comme guidée par un dieu, elle travaille avec une fébrile sublimité sur des papiers de
grandes dimensions, trempés dans leau pour faire se réabsorber les couleurs, et elle peint en déchirant les ténèbres rouges
carmin et noirs, quelle aime pourtant, avec des tourbillons gravides de densité matérielle et damples espaces fluorescents
dorange, de jaune et de vert, à la gouache, avec de la colle, à la tempera. Hadjira Preure a confiance dans les possibilités
énergiques de lessence humaine la plus secrète, elle opte donc sans incertitudes
pour une peinture intuitive, aperceptive, immédiate. Les résultats en sont évidents : sa peinture semble être un don
du ciel»..
Sur le mur parallèle, trois artistes se sont
partagés lespace, Nacer Izza, Yacine Brahami et Miloud Chenoudi. Nacer Izza, dans un style abstrait timbré de collage de photos
et de coupures de journaux nous renvoie au combat amazigh dAfrique du Nord avec Tizibwassa inspiré de la chanson de
Ferhat Mhenni, le maquisard de la chanson algérienne dexpression berbère, au message du chanteur kabyle Ait Menguellet qui
dénonce le fascisme et qui prône la tolérance entre les enfants dAlgérie, au
combat de Matoub Lounès, chantre de la chanson et du combat amazigh dAlgérie, à la magie de la chanson chaâbi dAlger qui fait
partie aussi du patrimoine algérien quelle soit en berbère ou en arabe algérien. Nouredine Djoudja quant à lui expose une
panoplie de céramiques quil a accrochées jalousement sur le modeste mur qui lui revient. Il parle de ses uvres comme si cétaient
des bijoux quon ne porte que rarement lors des évènements exceptionnels. À la
question des visiteurs sils pouvaient acheter ses uvres, Djoudja répond ironiquement :« Bien sûr que vous pouvez les acheter
mais, attention, elles sont fragiles ! Miloud Chenoufi de son côté tout
en se réclamant autodidacte, présente des uvres qui ont magistralement accroché
les visiteurs. Des portraits des femmes dAlger, des années soixante à nos jours deviennent vivants et imposants. Ils renvoient
lassistance à la douceur féminine voire maternelle de la femme, à la douleur dune femme ordinaire qui se retrouve à la rue
livrée à elle-même. Chénoufi décrit la beauté de la femme algérienne tout en dénonçant les injustices quelle subit.
À quelques mètres de toutes ces uvres magnifiques,
apparaissent les toiles de Mohamed saci. Dans un style figuratif criant et inondées de couleurs vives, Saci décrit les paysages
dAlger, du Sud dAlgérie mais également du Québec, du Canada. La nostalgie et la beauté des lieux qui habitent lartiste transpirent
de son travail.
Lécole des beaux Arts dAlger a formé des grands
artistes. Le Québec les découvre doucement mais sûrement. À suivre

Spectacle :
Parallèlement au lancement de lexposition,
un grand gala a eu lieu à lauditorium de Parc Extension. Il a drainé une foule nombreuse ( 350 personnes) et ce malgré le
froid et la grève du transport qui a paralysé lÎle de Montréal pendant quelques jours. La fête interculturelle a commencé
par les danses et les chants berbères assurés par les fillettes de la troupe Azzetta ( chants et danses berbères dAlgérie).
Le Groupe Anzar ( Dieu de la pluie chez les Berbères) a enchaîné avec les rythmes endiablés de Kabylie. Composé de Yacine
Kedadouche au chants, Achour à la guitare, Zahir au synthétiseur, Hakim Chérif
à la percussion, le Groupe Anzar qui vient juste dêtre créé à Montréal commence déjà à faire parler de lui et à être réclamé
par le public. Le duo Yacine et Sghira de la troupe Azzetta a également offert une magnifique
prestation avant de céder la place à Kamal Kouroughli pour nous transporter, grâce à sa voix chaude, dans le monde
des chants chaâbis dAlger. Vient enfin le groupe Alger Montréal de Brahim Sedik qui chante kabyle, rai et français pour clore en beauté la soirée.
Projections
vidéo :
Cest au Centre Afrika à Montréal, qua eu lieu
la projection-débat de deux documentaires. Le premier a porté sur un grand écrivain algérien dexpression française Kateb Yacine.
Cet écrivain fait-il le rappeler a été classé parmi les meilleurs écrivains francophones du 20ème siècle. À travers
ce documentaire, le réalisateur algérien Kamel Dehane a mis en évidence le talent, lhumanisme mais également la détermination
de Yacine à combattre lobscurantisme dans un pays ( Algérie) qui a tous les moyens
pour faire partie des meilleurs pays de la Méditerranée. Lassistance a pris part à un débat passionnant sur le rôle de lécrivain,
lintellectuel dans lédification dune société plurielle et juste. Le camerounais Emmanuel qui anime une émission Rythmes dAfrique
sur les ondes de CIBL est fasciné par le génie de Kateb Yacine. Il décide alors de lui consacrer une émission spéciale le
17 janvier 2004 pour inciter son auditoire montréalais à aller découvrir luvre phare de Yacine : Nedjma.
Le second documentaire, réalisé par la BBC
et présenté par Salman Rushdi, rend hommage au premier journaliste-écrivain algérien assassiné par la horde de la haine et
de lintolérance en 1993, Tahar Djaout. Dajout est lauteur entre autre des Vigiles et de Le dernier été de la raison qui sont
traduits récemment du français à langlais américain par e
Marjolijn de Jager. Ce documentaire qui nous montre une famille meurtrie suite à la perte dun être cher, une corporation de journalistes
terrorisée par le terrorisme intégriste, les partisans de lintolérance et de
la xénophobie aveugles qui persistent à défendre leur débilité, nous montre également la résistance des démocrates algériens
au prix de perdre leur vie. Vers la fin du documentaire, la fille de Djaout annonce
quelle poursuivra le chemin tracé par son père, quelle relancera le journal Rupture qui était cher à Tahar. Dans la
tête de ce grand journaliste et poète le combat doit continuer pour sauver la
république. Tahar Djaout disait, «Tu parles, tu meurs, tu te tais tu meurs, alors parles et meurs». Le débat qui sen est suivi
a tourné au tour de lintégrisme et des combats démocratiques en Afrique. Les intervenants nont pas cessé de faire le parallèle entre les acquis démocratiques du Québec pluriel et lintolérance qui sévit dans les
pays totalitaires qui répriment la diversité et les minorités.
Table ronde :
Le sens de lintégration
Tirrugza a clos ses activités de la semaine interculturelle
par une table ronde sur Le sens de lintégration qui a eu lieu également au centre Afrika. Quatre conférenciers-ères
ont abordé les préoccupations des immigrants au Québec, depuis leur arrivée jusquà leur installation voire leur intégration
effective dans leur nouvelle société. Julie Mareschal, anthropologue a dressé un tableau exhaustif sur les Kabyles qui vivent
au Québec. Raymonde Dallaire qui vient de la Rive sud a étalé son expérience dans laccueil et lintégration des nouveaux arrivants.
Lartiste- acteur Rabah Ait Ouyahia quant à lui, tout en croyant à la possibilité de sadapter à la vie de la société daccueil
insiste sur la clef de lintégration : le travail. Le professeur Lhocine Yahia enfin nous a communiqué son intervention sur le rôle des médias à faire connaître les immigrants dans le but de les rapprocher des Québécois, des Canadiens. Il
a pris comme exemple lémission berbère Amazigh Montréal et le bulletin Averroès que lassociation berbère Averroès publiait
dans les années 80 et 90. Lassistance a abondé dans le même sens que les conférenciers-ères. Le travail et la sensibilisation
de la société québécoise, les employeurs notamment. Ces derniers ne connaissent pas tellement les nouveaux arrivants, leurs
niveaux dinstruction. Doù la méfiance .Les intervenants interpellent encore une fois les institutions à arrêter dautres stratégies
pour que lintégration devienne effective. ( La table ronde animée par le sociologue Mabrouk Rabahi sera transcrite et publiée
bientôt).
Tirrugza
Montréal, janvier 2004
Ferhat Mhenni
Le Maquisard de la chanson kabyle engagée était à Montréal

Ferhat Mhenni lors du souper avec les membres de la communauté le 10 décembre 2003 à Montréal.

Sghira de la troupe Azetta ( chants et danses berbères d'Algérie), Yacine Kedadouche du groupe Anzar, Ferhat Mhenni,
Djamila Addar.

Ferhat Mhenni lors du souper avec la communauté kabyle au restaurant Copines de Chine,10 décembre 2003 à Montréal.
Éternels Berbères
«Je parle ici, non pas en homme de la rue, déclara-t-il
un jour à Genève en 1959, mais en homme qui se trouve moralement à la rue. Je veux dire que je ne représente rien. Je ne peux
représenter la France et la culture française : on m'en contesterait le droit, et on l'a déjà fait. Je ne peux pas représenter
non plus l'Algérie : on m'en contesterait le droit, et on l'a déjà fait, et ceux qui l'ont fait sont des hommes de gauche,
et même d'extrême gauche, qui m'ont dit que je n'avais pas le droit de parler des choses de la France, parce que je n'étais
qu'un Algérien, mais que je n'avais pas le droit de parler des choses de l'Algérie, et au nom des Algériens puisque je suis
un Algérien francisé, le plus francisé des Algériens. ».
Jean Amrouche

QUÉBEC INTERCULTUREL
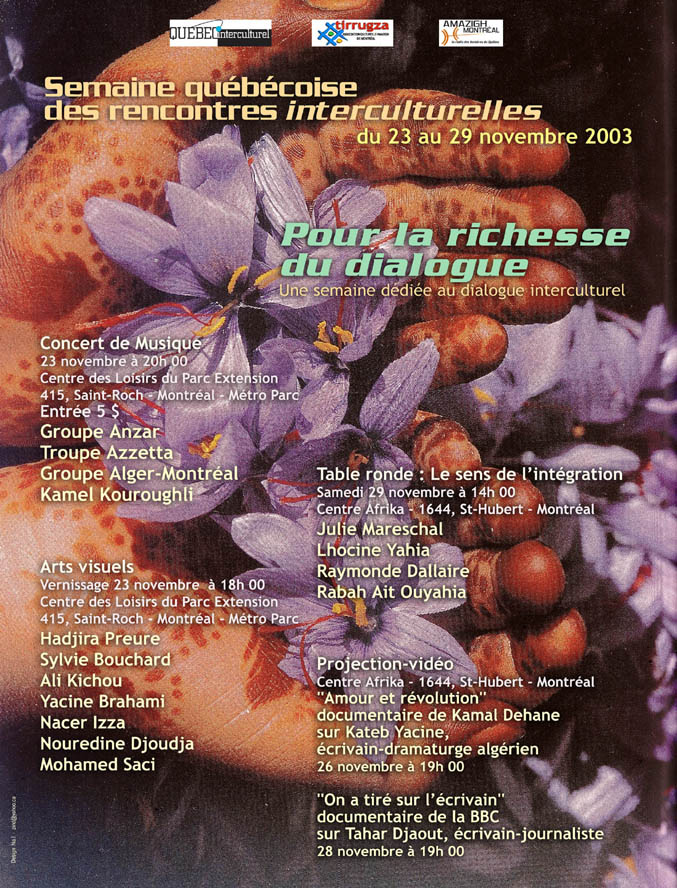

Différents mais tous pareils...
Communiqué, Montréal, novembre 2003
Dans cette
modeste participation à la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, TIRRUGZA souhaitera mettre
en évidence les efforts déployés par la communauté berbère à promouvoir sa culture
dorigine en allant vers les autres, en sinspirant de la culture de lAutre et surtout en tissant des liens avec toute la mosaïque
culturelle du Québec.
Lintégration des gens issus des différentes
origines se situe dans leur possibilité dexercer leur citoyenneté dune façon
effective dans leur nouvelle société. Et cette intégration passe inévitablement par un travail décent et une reconnaissance
de leurs acquis. Il est évident que lécho à leurs doléances passe par la reconnaissance de ce quils sont et de ce quils ont
comme héritages historique et culturel. Héritage devant être conjugué avec la richesse culturelle du Québec contemporain.
Richesse culturelle pleinement assumée par les différents partenaires sociaux dans un esprit douverture, de tolérance et de
respect mutuel.
La communauté berbère nord-africaine fait partie du paysage culturel québécois.
Elle essaye, avec les moyens dont elle dispose, de contribuer à instituer dans lespace public et limaginaire du Québec daujourdhui
les valeurs ci-haut mentionnées. Et sa contribution se manifeste dans différents domaines : culturel, scientifique, académique
et artistique.
Dans le cadre de cette semaine, nous avons conçu un programme varié devant
donner une idée précise, voire une image adéquate des efforts déployés aux niveaux commaunautaire, culturel et intellectuel
par plusieurs acteurs. Et cela afin dassoeoir des traditions dintégration au sein de la société dacceuil. En effet, des artistes-peintres,
des femmes, des chanteurs berbères ont réussi en un temps record à se faire une place dans lespace culturel québécois. Cependant,
toutes ces entreprises nobles et de qualité ne peuvent être fructueuses si elles ne touchent pas lensemble de la société québécoise
contemporaine, si elles ne créent pas une intéraction entre les différentes cultures qui composent le Québec daujourdhui.
Cette manifestation culturelle qui sera animée par des particpants-es de plusieurs
origines se veut rasembleuse, car le fait de rapprocher les différences et vivre
dans la diversité constituent un défi majeur à relever dans une société plurielle et ouverte sur le monde et ses cultures.
TIRRUGZA
Montréal, octobre 2003
Au programme :
A)-Exposition : rapprochement par les arts visuels.
Centre Les Loisirs du Parc-Extension, 415, Saint-Roch.
Les arts visuels
ont prouvé plus dune fois les capacités à communiquer des messages et des sensibilités dans une approche universelle. Un grand
peintre, Ali Kichou, dont les uvres sont exposées dans les plus grands musées du monde exposera ses uvres aux côtés de plusieurs
artistes algériens et québécois.
Les artistes peintres :
Brahami Yacine
Saci Mohamed
Djoudja Nouredine
Sylvie Bouchard
Hadjira Preure
Ali Kichou
Nacer Izza
Vernissage le 23 novembre à 18H au Parc-Extension
Responsable : Ali Kichou
B) Spectacle le 23 novembre à 20H: Rapprochement par la
musique
Centre Les Loisirs du Parc Extension, 415, Saint-Roch.
Tel: 277-6471
Entrée 5$.
Accueil : 19H
20H00 : Mot de bienvenue
20H15 : Sghira et Yacine Kedadouche
20H30 : Azzetta : Troupe de Chants et danses berbères
dAlgérie
21H : Groupe Anzar
22H15 : Groupe Alger-Montréal
Animation Wahiba Amzal, journaliste-animatrice
C)- Table ronde : Le sens de lintégration
Centre Afrika-1644 St-Hubert. Tel: (514) 843-4019
Samedi 29 novembre, 14h
Rapprochement par
la recherche, la vulgarisation et le dialogue.
Animation : Mabrouk Rabahi, sociologue et animateur radio
D)- Projection-vidéo: Rapprochement par la pensée et lécriture
Centre Afrika-1644 St-Hubert. Tel: (514) 843-4019
19H : Mercredi 26 novembre, Amour et révolution documentaire
de Kamal Dehane sur Kateb Yacine, écrivain dramaturge algérien francophone.
19H : vendredi 28 novembre, On a tiré sur lécrivain documentaire de la BBC sur Tahar Djaout, écrivain
journaliste.

YACINE KATEB (1929-1989)
Kateb Yacine est né en 1929 à Constantine,
dans un milieu qui sut lui apporter, avec le sentiment de son appartenance tribale, un contact familier avec les traditions
populaires du Maghreb. Après lécole coranique (quil apprécia peu), il fréquenta lécole française, pour laquelle il nourrit
des sentiments contradictoires : il y était « dans la gueule du loup », mais, en même temps, il y découvrit
la vertu libératrice de lesprit critique. Le 8 mai 1945, il participe à la grande manifestation des musulmans qui protestent,
à Sétif, contre leur situation inégale. Dans la répression terrible qui sensuit, il est arrêté, brutalisé, emprisonné :
une fois libéré, il est exclu du lycée. Mais lexpérience de la prison lui a révélé « les deux choses qui [lui] sont les
plus chères : la poésie et la révolution ». Proche des milieux nationalistes, inscrit au Parti communiste, il travaille
un temps comme journaliste à Alger républicain, puis, en 1951, il sexile en Europe, où il fait éditer roman et pièces de théâtre.
Il rentre en Algérie en 1972, où il dirige une troupe théâtrale que les autorités préfèrent reléguer à Sidi-bel-Abbès, dans
lOuest algérien. Ses prises de position, toujours attendues et toujours fidèles à lesprit du soulèvement de 1954, nont jamais
cessé dappeler à la libération de lAlgérie (ainsi en octobre 1988, quand il proteste contre la répression des manifestations
algéroises).
Son uvre, commencée
en 1946 avec un recueil poétique, Soliloques, sest développée dans léparpillement de publications dispersées, oubliées, reprises,
récrites, étoffées ou découpées. Le Cadavre encerclé, paru dans la revue Esprit en 1954, créé à la scène par Jean-Marie Serreau
en 1958, célèbre, dans une langue abruptement imagée, lépopée du soulèvement anticolonial et, en même temps, déplore le destin
tragique du héros, confronté aux tabous de sa société, à la toute-puissance et à la trahison des pères. Le roman Nedjma (1956)
reprend des personnages et des situations de la pièce et développe des fragments antérieurement publiés. Bien que tronqué
par léditeur, il simposa demblée comme une uvre majeure. Une structure éclatée et répétitive, entrecroisant les destins de
quatre jeunes gens, la multiplication des points de vue, le mélange des formes romanesques et poétiques, le jeu sur la temporalité,
le recours au mythe, la plongée, par le monologue intérieur, dans la conscience des héros, tous ces éléments ont déconcerté
et fasciné les lecteurs qui ont appris à y lire une « anthropologie poétique de lAlgérie » (J. Arnaud).
En 1959, un
volume de théâtre, Le Cercle des représailles, préfacé par Édouard Glissant, rassemble une tragédie, un monologue lyrique
et une comédie (Les ancêtres redoublent de férocité, Le Vautour, La Poudre dintelligence). Le Polygone étoilé (1966) réunit,
dans la discontinuité du « chaos créateur », des textes de tous genres. J. Arnaud lui donnera un prolongement
en assemblant Luvre en fragments (1986), qui collecte inédits et textes retrouvés pour construire un étonnant monument de
blocs épars.
Dun voyage au Vietnam
en guerre, Kateb Yacine avait rapporté une pièce, LHomme aux sandales de caoutchouc (1970), qui exaltait la figure de Hô Chi
Minh. En Algérie, il se toume vers un théâtre politique en langue populaire, quil conçoit comme une pédagogie libératrice.
Il écrit et met en scène, en arabe algérien, Mohammed prends ta valise (1971), La Voix des femmes (1972), La Guerre de 2 000
ans (1974), Le Roi de lOuest (1977), Palestine trahie (1978). Il revient au français, à loccasion dune commande dans le cadre
de la célébration du bicentenaire de la Révolution française, et compose une fresque sur les révolutions, à partir du personnage
de Robespierre : Le Bourgeois sans-culotte, ou le Spectre du parc Monceau.

Tahar DJAOUT 1954-1993.
Victime le
26 mai 1993 dun attentat deux balles dans la tête, tirées à bout portant, , lécrivain algérien Tahar Djaout est
mort le 2 juin à Alger. Son décès a suscité la plus grande consternation : journaliste à lhebdomadaire Algérie-Actualité,
puis rédacteur en chef de Ruptures, quil avait contribué à fonder au début de 1993, il était resté étranger aux cercles du
pouvoir dÉtat et manifestait dans ses articles, traitant essentiellement de thèmes culturels, son choix de la modération et
de la tolérance. Tahar Djaout est né le 11 janvier 1954 à Azeffoun en Kabylie maritime. Après des études qui le conduisent
des mathématiques aux sciences de linformation, il devient journaliste en 1976. Ses premières publications avaient été des
plaquettes de poèmes : Solstice barbelé (édité au Québec en 1975), LArche à vau-leau (Paris, 1978), Insulaire & Cie
(Alger, 1980), LOiseau minéral (Alger, 1982).Un roman, LExproprié (publié à Alger en 1981, réédité à Paris en 1991), puis
un recueil de nouvelles, Les Rets de loiseleur (Alger, 1983), vont inventer une écriture de recherche, jouant sur les transgressions
et autres manipulations de texte.
LExproprié se présente
comme le récit dun voyage en train qui est aussi un procès : les voyageurs seront condamnés à descendre selon lénoncé
des verdicts. Lécriture est volontairement hétérogène, bousculant les voix, détournant le langage figé. Il en va de même dans
les nouvelles, qui, par lenchevêtrement des points de vue, par la déconstruction des codes comme par lusage du pastiche (de
Camus ou de Kafka), invitent à un questionnement systématique.
Avec Les Chercheurs dos, roman publié en
1984 à Paris, le talent littéraire de Tahar Djaout a été plus largement reconnu. Le récit est celui dune quête étrange :
le narrateur, un adolescent, sest joint à une équipe de « chercheurs dos » qui parcourt lAlgérie pour retrouver
les corps des disparus, tombés aux quatre coins du pays pendant la guerre de libération. Le jeune homme récupérera les ossements
de son frère aîné et les reconduira au village : mais pour quel avantage, sinon pour assurer le triomphe de la mort ?
Le regard naïf du jeune homme débusque les frilosités, les léthargies, les mensonges dune Algérie repliée sur son passé récent.
LInvention du désert
(Paris, 1987), dune construction très complexe, entremêle des impressions de voyage vers le désert du Sud ou lArabie, des
souvenirs denfance et le récit du pèlerinage dun aïeul, des proses poétiques sur loiseau « maître du mouvement »
et « horloge du monde », une évocation du Maghreb médiéval, quand la dynastie almoravide affrontait les Almohades.
Les Vigiles (Paris,
1991) tient, lui, du conte philosophique : un jeune professeur algérois, qui a mis au point un métier à tisser dun type
révolutionnaire, ne parvient pas à faire breveter son invention. Il se heurte à toutes les tracasseries administratives, jusquau
moment où il est primé à létranger : les autorités font alors retomber la responsabilité des difficultés sur un bouc
émissaire peu à peu conduit au suicide. Au-delà de la bureaucratie, cest toute une réalité sociale algérienne qui est exposée,
sans la moindre complaisance.
Le regard critique
que Tahar Djaout portait sur la société algérienne daprès lindépendance excluait lintransigeance, le parti pris, les facilités
verbales. Il préférait le sourire de létonnement, linquiétude du doute, lesprit de liberté. Cest peut-être pourquoi on la
assassiné.
QUÉBEC
INTERCULTUREL
Du 23 au 29 novembre 2003
Semaine québécoise des rencontres interculturelles
Pour la richesse du dialogue « Une semaine dédiée au dialogue interculturel » Michelle Courchesne,
ministre des Relations avec les citoyens et de l'Immigration
Communiqué
Semaine québécoise des rencontres interculturelles
"Une semaine dédiée au dialogue interculturel" - Michelle Courchesne,
ministre des Relations avec les citoyens et de l'Immigration
MONTREAL, le 8 oct. /CNW Telbec/ - La ministre des Relations avec les citoyens et de l'Immigration, madame Michelle
Courchesne, annonce la tenue de la Semaine québécoise desrencontres interculturelles qui se déroulera du 23 au 29 novembre
2003 sous le thème Pour la richesse du dialogue. "La Semaine québécoise des rencontres interculturelles est un moment privilégié
qui marque la volonté du gouvernement du Québec de raffermir les liens avec les différentes communautés venues enrichir le
Québec, a déclaré la ministre Courchesne. La Semaine démontre également l'engagement du gouvernement à susciter le dialogue
entre les diverses communautés qui forment le Québec d'aujourd'hui." Des activités, organisées par des partenaires et des
organismes de plusieurs régions du Québec, auront lieu tout au long de la Semaine. Elles permettront de souligner l'importance
et la richesse du dialogue interculturel et son influence positive sur l'ensemble de la société québécoise. La programmation
détaillée des activités nationales et régionales sera dévoilée au cours du mois de novembre et sera disponible dans la section
"Québec interculturel" du site Internet du ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration (www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca).
"L'intégration réussie des communautés et les relations interculturelles harmonieuses reposent sur une responsabilité partagée
par l'ensemble de la société. Une intégration réussie, c'est le partage d'expériences et le développement de relations continues
afin que toutes les Québécoises et tous les Québécois puissent participer au développement économique, social et culturel
du Québec", a conclu madame Courchesne qui poursuit une tournée de consultation entreprise à la mi-août, sur les relations
interculturelles, l'immigration et l'intégration des nouveaux arrivants.
Source : Daniel Desharnais Attaché de presse Cabinet de la ministre des Relations avec les citoyens et de l'Immigration
(514) 873-9940
Renseignements : Marie-Josée Duhamel Direction des affaires publiques et des communications Ministère des Relations
avec les citoyens et de l'Immigration
(514) 864-3664
-30-
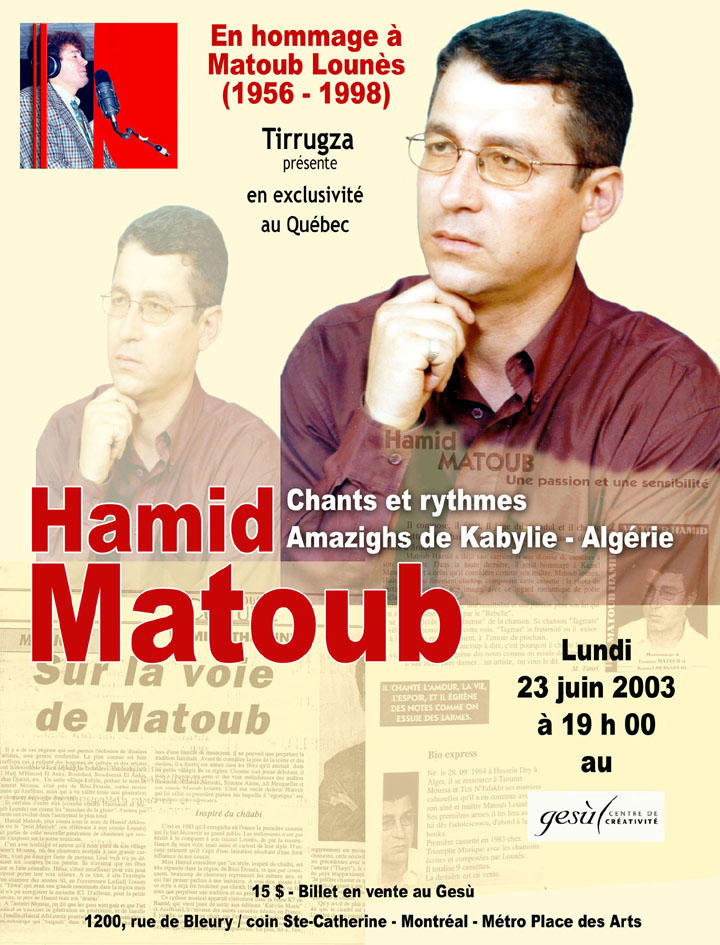
Hamid Ath Lounissur la voie de
Matoub Lounès
La conscience : Amek itagganem ?
Invité par lassociation de culture amazighe de Montréal Tirrugza, Hamid Ath
Lounis ou le petit Matoub sera à Montréal en ce 23 juin 2003 pour rendre hommage à son cousin Matoub Lounès, ce chantre de
la chanson amazighe dAlgérie assassiné en 1998 par la horde de la haine en Kabylie. Beaucoup de gens ne font aucun lien entre
Matoub et Hamid Ath Lounis. Mais, quand ils prennent connaissance de ce lien de parenté, ils restent hébétés en se demandant
pour quoi Hamid avait opté pour le nom de Ath Lounis et non pas Matoub ?
Hamid, selon ses dires à la presse algérienne dexpression française, a adopté ce pseudonyme pour éviter toute confusion
avec les autres artistes de la grande famille Matoub ( Matoub Achour, Moh Samaïl, Lounès Hamid et Mohammed). Toujours, selon
les propos de Hamid, Matoub Lounès lui a suggéré, lors de lenregistrement de
son premier album à Paris en 1983, de se donner carrément le nom de la Tribu Matoub : Ath Lounis. Hamid Matoub porte également le nom du Petit Matoub. Un titre qui nous révèle quil est vraiment lélève
et est dans le sillage de Matoub Lounès et des chanteurs chaâbi de la Région comme El Hasnaoui. Hamid a la voix, la persévérance
et le talent de simposer sur scène avec son identité artistique à lui. Les similitudes avec le style du Rebelle existe certes,
mais, dans le même temps, Hamid revendique son appartenance à la famille du chaâbi kabyle de Ath Douala qui ont influencé
Lounès et beaucoup dautres.
Hamid Ath Lounis ou Le petit Matoub, est né en 1964 à lHussein Dey à Alger. Il a passé une grande partie de sa vie à Ath Douala, en Kabylie.
Il y avait ses amours et ses repères culturels et musicaux. Il a préféré vivre à Taourirt Moussa que de continuer son cursus
scolaire à Bachdjara, à Alger et ce, malgré la colère de son père. La Kabylie était son école sur tous les plans, musical
notamment. Pour cause, il a côtoyé Matoub Lounès à ses débuts. Son premier album, sorti en 1984 à Paris chez Triomphe-Musique,
est de Matoub Lounès, entièrement, parole et musique. Mieux encore, Hamid a eu cette chance inouïe de chanter à louverture
ou à lentracte de certains galas quanimait son cousin Lounès en Kabylie, à Alger. Sa carrière est étroitement liée
à son tempérament de fonceur et daventurier kabyle et algérois. Il est habité par ces deux cultures. Ce qui explique cet attache
quil a à la fois pour Matoub Lounès et pour Kamel Messaoudi pour lesquels il rendu hommage dans lun de ses albums tout en
prônant la solidarité et la paix entre Algériens. Il chante en kabyle mais du châabi kabyle.
Après le
succès du premier album signé par Matoub Lounès, Hamid décide de composer pour lui-même. Deux
albums se sont succédés en 1985 et 1986. Les thèmes de ses albums tournent autour du combat identitaire amazigh,
de lamour, de la patrie, des choses de la vie. Awah Awah, Djethas Taqas Nadia ( Laissez la place à Nadia), Qimed qimed
ayahbib ( Assis-toi lami). A tamurt iw Azizen ( mon cher pays), Amek itagganem ( La conscience), sont autant de thèmes quil
traite et quil rend très bien avec sa voix chaude et sa mandoline.
Hamid a chanté en Algérie, en Europe. Le voilà en ce mois
de juin 2003 à Montréal, au Québec pour commémorer le quatrième anniversaire de lassassinat du chantre de la chanson amazighe
engagée Matoub Lounès. Cet hommage sera enrichi par la contribution de la troupe de chants et de danse de Kabylie Azzetta,
les artistes et fans de Matoub Lounès Karim Slamani, Omar Mékaoui et Yacine Kedadouche. Matoub est toujours là. La relève
kabyle aussi ! Comme dirait Lounès El Wadjeb Assirem ad yilli. Soyons optimistes,
les jours meilleurs sont à venir ! Tout est affaire de conscience.
Djamila Addar,
Montréal
Je terminerai par cet extrait tiré de ta pièce
théâtrale, La guerre de 2000 ans où tu avais chanté l'Algérie et son histoire millénaire :
"Ô Algérie tu es sacrifiée
Et le cur qui saigne
Je
voudrais l'étouffer
La malédiction des ancêtres
Est trop forte "
Et j'emprunterai cette
citation à la Kahina qui s'adressait à ses agresseurs en ces termes :
"C'est nous, dans ce pays, qui combattrons
la barbarie
Adieu marchand d'esclaves
Je vous laisse l'histoire au cur
De mes enfants
Je vous laisse Amazighs,
Cur de l'Algérie".
Kateb Yacine
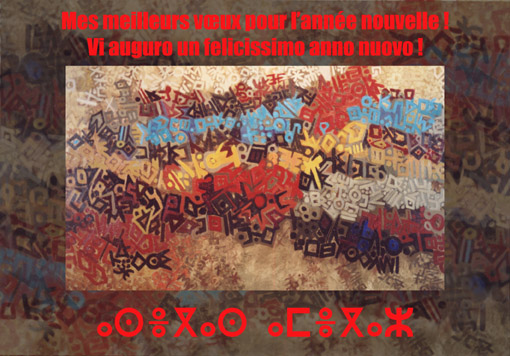
Enter subhead content here
|